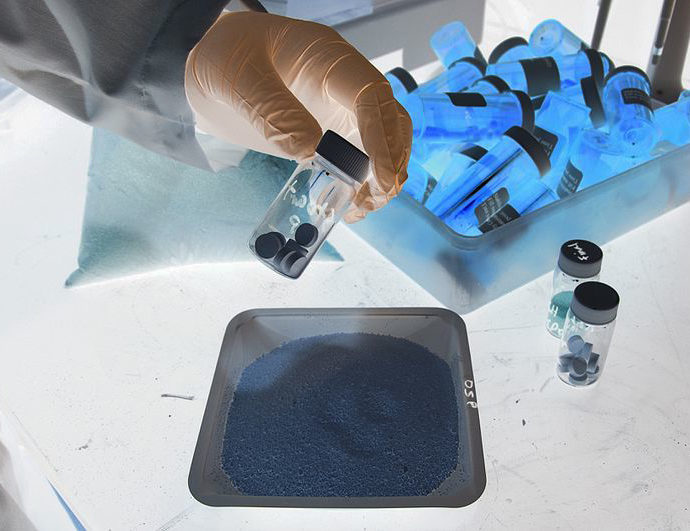Alors que des essais de médicaments et un essai vaccinal ont débuté, Olivier Schwartz, le directeur de l’Unité Virus et Immunologie à l’Institut Pasteur, fait le point sur les recherches.
Interview réalisée pour la préparation du «Virus au Carré» animé par Mathieu Vidard, sur France Inter le 20 mars 2020:
Où en est-on sur la recherche d’un vaccin contre le SARS-Cov-2, le virus de l’épidémie de Covid-19?

Quarante essais vaccinaux sont d’ores et déjà prévus dans le monde. Le premier a été lancé aux Etats-Unis il y a quelques jours. Il existe deux stratégies pour la conception d’un vaccin. La première, qui est utilisée contre la grippe, consiste à utiliser le virus cible et à le désactiver. De cette manière il crée chez la personne une réponse immunitaire sans qu’elle contracte la maladie. A Pasteur, nous utilisons la seconde stratégie, qui consiste à utiliser un vaccin existant contre un autre virus, et à lui ajouter par génie génétique un antigène contre le SARS-Cov-2. Nous utilisons, à Pasteur, le vaccin contre la rougeole, dont on sait qu’il est très efficace et très bien toléré par les humains. Et nous lui ajoutons ce qu’il faut pour générer une réponse immunitaire contre le Sars-Cov-2, ce qui permet à l’organisme de produire des anticorps empêchant le virus de pénétrer dans les cellules.
Combien de temps faut-il pour mettre un vaccin au point et le mettre sur le marché?
Cela prend de 12 à 24 mois. Car il faut s’assurer de son effet clinique, de sa non-toxicité, et déterminer la meilleure méthode pour le fabriquer tout en assurant la meilleur qualité possible des lots. A Pasteur, nous nous appuyons sur les recherches qui avaient été menées à l’époque de l’épidémie de SRAS (2002-2003) provoquée par un autre virus, le SARS-Cov. Notre candidat-vaccin marchait très bien sur un modèle animal. Après la fin de l’épidémie, nous avons suspendu ces recherches, mais cette expérience est très profitable aujourd’hui, car nous ne partons pas de zéro: le SARS-Cov-2 et le SARS-Cov partagent environ 80% de leur code génétique.
Où en êtes-vous, à l’Institut Pasteur, dans vos recherches d’un vaccin?
Nous sommes dans ce que nous appelons la phase pré-clinique. Nous nous assurons, avec un modèle animal, la souris, que les virus de la rougeole modifiés sont stables, qu’ils produisent bien la réponse immunitaire attendue et que le système immunitaire le repère et fabrique des anticorps dirigés contre lui. Si tout va bien, nous choisirons un candidat-vaccin dans quelques mois et commenceront les essais cliniques.
Avec un essai clinique sur des volontaires déjà engagé, les Etats-Unis ont-ils pris de l’avance?
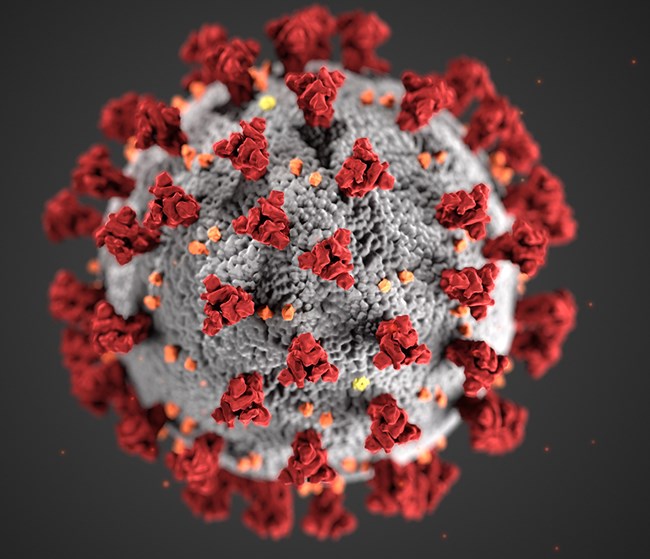
On ne peut pas raisonner de cette manière. L’essai américain s’appuie sur un produit complètement nouveau dont les chercheurs ne savent pas, par exemple, s’il est toxique ou pas. Ces essais cliniques seront nécessairement longs pour cette raison. En utilisant un vaccin déjà bien connu comme celui de la rougeole, on réduit la durée des essais cliniques sur les humains une fois le candidat-vaccin mis au point. Il faut se méfier des effets d’annonce. Le vaccin testé aux Etats-Unis est porté par Moderna, une société cotée en bourse, dont l’action a profité de cette annonce.
Où en est-on des traitements pour les personnes qui ont développé le covid-19? On parle beaucoup de la chloroquine, ce médicament contre le paludisme…
Oui, on l’utilise aussi pour des maladies auto-immunes, certains lupus, par exemple. Cette molécule, comme l’hydroxy-chloroquine, ont montré qu’elles ont parfois un effet anti-viral en empêchant l’entrée du virus dans les cellules. En Chine, il semble que des effets bénéfiques aient été constatés sur des patients. De même, l’équipe d’Eric Raoult a obtenu des résultats intéressants mais encore très préliminaires —et sur un petit nombre de patients— en associant la chloroquine et un antibiotique. Mais ces résultats n’ont pas encore été publiés dans une revue scientifique donc il faut être prudent. De plus, les doses utilisées ne sont pas très éloignées de la dose toxique. La fenêtre thérapeutique est très étroite sur cette molécule. Compte-tenu de sa toxicité, il faut une solide étude Bénéfices/Risques. C’est pour cela qu’il ne faut pas chercher à s’en procurer et que les médecins ne doivent pas en prescrire, tant que la démonstration scientifique n’est pas faire.
Quels essais sont prévus en France?
Le gouvernement a lancé un essai qui portait au départ sur trois traitements: un groupe de patients malades reçoit du Remsedivir, un antiviral de la firme Gilead, qui n’est pas encore sur le marché, mais qui a montré un effet sur le virus Ebola. Le second groupe reçoit du Kaletra, un médicament qui fait partie de l’arsenal contre le virus HIV. Le troisième reçoit du Kaletra associé à de l’interféron B pour stimuler la réponse immunitaire. Un quatrième traitement ajouté à cet essai est la chloroquine testée à Marseille. Sanofi a d’ailleurs proposé de mettre de nombreuses doses à disposition des autorités sanitaires [de quoi traiter 300 000 patients, NDLR].
Les résultats obtenus seront ensuite comparés à ceux d’un groupe de patients qui est soigné sans traitement particulier, comme c’est le cas dans tous les hôpitaux. Ces molécules sont toutes déjà sur le marché ou étaient en passe de l’être (Remsedivir): la procédure d’homologation pour cette application au covid-19 sera donc beaucoup plus rapide que pour une molécule totalement nouvelle.
En Chine, les médecins prélèvent du sang de patients guéris pour extraire des anticorps et les injecter aux malades. C’est efficace?
Cela se fait aussi au Japon et cela semble donner des résultats. Il s’agit d’extraire de l’immunoglobuline du sang des donneurs puis de la purifier avant de l’injecter aux malades. Le problème avec cette approche est qu’on ne peut pas disposer d’autant d’immunoglobuline que nécessaire. Le gouvernement chinois a fait un appel aux malades guéris pour qu’ils donnent de leur sang. Mais les quantités sont forcément limitées. D’autres équipes utilisent une stratégie un peu différente, en essayant de produire cette immunoglobuline comme on produit d’autres médicaments. Cela consiste à récupérer des globules blancs de patients guéris, puis à identifier quel est le bon anticorps monoclonal. Ensuite on le fabriquera par génie génétique, ce qui permettra d’avoir un processus de production contrôlable, et de ne pas dépendre de dons du sang. Nous travaillons aussi dans cette direction à Pasteur.
D’autres molécules sont-elles à l’étude?
Oui, de nombreux laboratoires de recherche sont en train de cribler des milliers de molécules qui sont déjà sur le marché. Cela passe par des modélisations, puis des tests cellulaires.
Pourquoi est-ce si difficile de développer des médicaments anti-viraux?
Ce n’est pas que c’est plus difficile que pour d’autres pathologies, c’est que c’est très long. Mais il y a eu de beaux succès dans les molécules antivirales, puisqu’aujourd’hui, on a pu transformer le Sida en une maladie chronique. Et le Tamiflu est parfois efficace contre la grippe. Mais un virus est un organisme particulièrement complexe à cibler: il est tout petit et il mute en raison de pressions de sélection naturelle. De plus, les virus pénètrent à l’intérieur des cellules, où il est difficile de les déloger. D’ailleurs, les virus formés d’ADN peuvent ensuite s’intégrer au bagage génétique des cellules infectées [variole, herpès, papillomavirus, virus diarrhéiques, NDLR]. Ce n’est pas le cas des virus ARN, comme le SARS-Cov-2 et les autres coronavirus [ainsi que grippe, rougeole, ebola, polio, fièvre jaune etc. NDLR].
Rien qu’en janvier et février, près de 500 travaux sur le virus et l’épidémie ont été publiés dans des revues scientifiques. N’y-a-t-il pas un risque que des travaux peu solides soient publiés et ensuite évoqués dans les médias, induisant le public et les autorités sanitaires en erreur?
Il existe deux types de publication. Celles qu’on appelle les pré-publications (preprint) sont mis en ligne sur des serveurs spécialisés sans avoir passé les filtres de la publication scientifique. Cela permet aux auteurs d’avoir un regard critique sur leurs travaux. Ce n’est pas pour que les médias en fassent la Une. Ensuite, il y a les publications dans les revues [en ligne et imprimées, NDLR] dont beaucoup utilisent la relecture par les pairs pour valider les résultats. Il y a des revues sérieuses et d’autres moins. Mais même les grandes revues publient parfois des résultats peu fiables.
Cela s’est produit récemment pour une étude allemande qui a expliqué qu’une femme arrivée de Chine —et sans symptômes— a contaminé plusieurs personnes à l’occasion de réunions à Münich, avant de tomber malade quelques jours plus tard, une fois rentrée chez elle (Lire ci-dessous). Mais les chercheurs n’avaient même pas pris le soin de l’interroger. Il s’est avéré qu’elle était bien malade en Allemagne, mais qu’elle avait pris du paracetamol! Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de transmission asymptomatique, car il y en a très vraisemblablement. Mais cela montre que cette frénésie de publication pose un vrai risque. Le temps de la science est hélas plus lent que le temps des épidémies.
Propos recueillis par Denis Delbecq
Une transmission asymptomatique qui n’en était pas une
Une femme arrivée de Chine à Münich a contaminé une personne à l’occasion d’un rendez-vous, qui est ensuite tombée malade, contaminant directement et indirectement trois autres personnes de leur entreprise. Une fois rentrée en Shanghai, cette femme est tombée malade. Autrement dit, il s’agirait d’un cas documenté de transmission du covid-19 avant l’apparition des symptômes, qu’une équipe de Munich s’est empressé de signaler au New England Journal of Medicine, qui a publié leur « lettre à l’éditeur » le 30 janvier. Même Anthony Fauci, le président de l’Institut américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), qui conseille Trump, s’y est laissé prendre, raconte un journaliste —basé à Berlin— de la revue scientifique Science.
Suite à la publication de cette lettre des scientifiques, les autorités sanitaires ont enquêté. En interrogeant par téléphone cette femme chinoise de retour à Shanghai, il s’est avéré qu’elle était bien malade à Munich. Selon un informateur de la revue Science, elle souffrait de fatigue et de douleurs musculaires et avait pris du paracetamol pour se sentir mieux, d’où l’absence de symptômes visibles! Mais le plus grave dans cette affaire, c’est que l’enquête allemande a montré que les chercheurs allemands n’avaient jamais interrogé cette femme. Ils ont seulement questionné des personnes qu’elle avait côtoyé en Allemagne, et qui ont répondu qu’elle n’avait pas de symptômes. Mais cela pas empêché les chercheurs de soumettre leurs travaux au NEJM, qui s’est empressé de les publier!
Pour se dédouaner, un des signataires de ces travaux a expliqué à mon confrère Kai Kupferschmidt de Science que «apparemment cette femme n’avait pas pu être jointe mais que les chercheurs pensaient qu’il fallait communiquer rapidement leurs observations». Elles ont déjà été citées en référence par près de 90 autres travaux. Selon Science, les autorités sanitaires ont signalé leurs découvertes à l’OMS et adressé un courrier au NEJM. Six semaines plus tard, au moment ou nous écrivons ces lignes, l’article est toujours en ligne, sans mention de cette histoire.
D.Dq